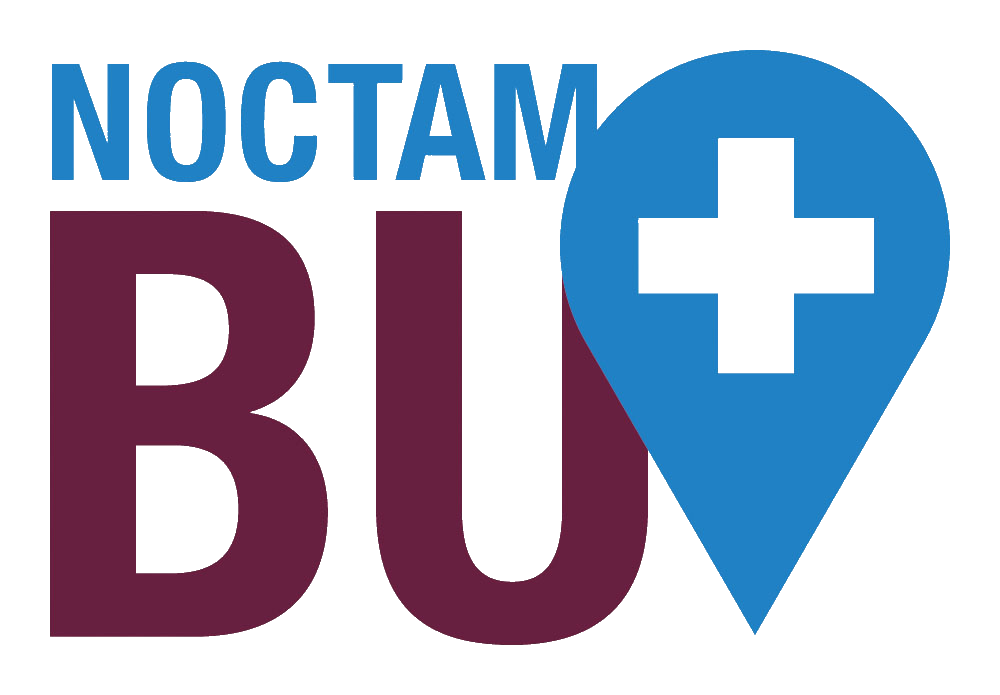Lancement de la réforme LMD, c'était en avril 2002

Jusqu'en 2002, le système français de l’enseignement supérieur obéissait au schéma DEUG, Licence, Maîtrise et Doctorat. Le 8 avril 2002 par décret, le système français de l'enseignement supérieur s'engage sur la voie de l'harmonisation des études supérieures et des diplômes nationaux avec l'espace européen de l'enseignement supérieur.
Initiée par les ministres de l’Education nationale du Royaume-Uni, d’Allemagne, d’Italie et de France à Paris en mai 1998, poursuivie à Bologne en 1999, puis à Prague et Berlin respectivement en 2002 et 2003, cette transformation progressive de l'offre de formation a connu sa dernière évolution en 2016. La loi du 23 décembre 2016 crée le diplôme national de master. La réforme appelée pendant un certain temps « 3, 5, 8 » par rapport au temps d'étude, est désormais dite « LMD ».
Le système LMD est bien plus qu'une nouvelle architecture en trois grades, semestres et crédits ECTS. Il s'agit non seulement de faire du continent européen un espace permettant la mobilité des étudiants et des enseignants-chercheurs mais d'en faire un espace attractif à l'échelle du monde entier. Les processus de Bologne et de Lisbonne continuent de modeler le monde universitaire et de le mettre à l'épreuve de la concurrence; il est fait référence notamment au classement annuel de Shanghaï dans lequel l'Université des Antilles figure. La plupart des universités françaises ont mis en place la réforme LMD. De nombreux établissements universitaires de par le monde s'intéressent à ce processus et de plus en plus d'accords de reconnaissance mutuelle de diplômes sont signés.
Ressources imprimées de la BU
- Denis, Jean-Philippe et al. L’enseignement supérieur en transition : propositions pour l’avenir. Caen: Éditions EMS, Management & société, 2024 (378.44 ENS).
- Chevaillier, Thierry, et Christine Musselin. Réformes d’hier et réformes d’aujourd’hui : l’enseignement supérieur recomposé. Rennes: PUR, 2014 (378 REF)
- Frédéric Forest, réal., Les universités en France. Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2021, 458 pages (378.44 UNI) .
- Frédéric Forest, réal., Les universités en France. Fonctionnement et enjeux, Mont-Saint-Aignan, Publications des universités de Rouen et du Havre, 2012, 296 pages (378 UNI).
- Cosnefroy, Laurent et al. L’internationalisation de l’enseignement supérieur : le meilleur des mondes ? Louvain-La-Neuve: De Boeck Supérieur, 2020 (378.1 INT) (version en ligne).
Ressources en ligne de la BU
- Couppié, Thomas, Arnaud Dupray, Céline Gasquet, et Philippe Lemistre, éd. Enseignement supérieur : nouveaux parcours, nouveaux publics. Marseille: Céreq, 2021.
- Baumgartner, Etienne, Solle, Guy. "Établissements universitaires : changements institutionnels et approche client. Quelle pertinence ?", Politiques et Management public, 2006, 24-3,p. 123-14
- Gail Taillefer, “Le défi culturel de la mise en œuvre du Cadre européen commun de référence pour les langues : implications pour l’enseignement supérieur français”, Les cahiers de l'APLIUT, Vol. XXVI N° 2 | 2007, 33-49.
- Pitseys, John. « Le processus de Bologne ». Revue interdisciplinaire d'études juridiques, 2004/1 Volume 52, 2004. p.143-189.
- Frelat-Kahn, Brigitte.« Des élites nationalistes dans un contexte de globalisation ? ». Le Télémaque, 2011/1 n° 39, 2011. p.11-16.
- Mazzella, Sylvie, éd. L’enseignement supérieur dans la mondialisation libérale. Tunis: Institut de recherche sur le Maghreb contemporain, 2007.
Ailleurs, sur internet
- Béatrice Verquin Savarieau. CNED. (2019, 17 janvier). Ce que les modèles économiques nous apprennent des changements en cours dans les universités françaises , in Les politiques et les enjeux.
- MESR, La mise en place du LMD. Rapport n°2005-031, juin 2005.
- Assemblée nationale, Rapport n°4181 d'information sur l'évaluation de la loi du 23 décembre 2016, mai 2021.