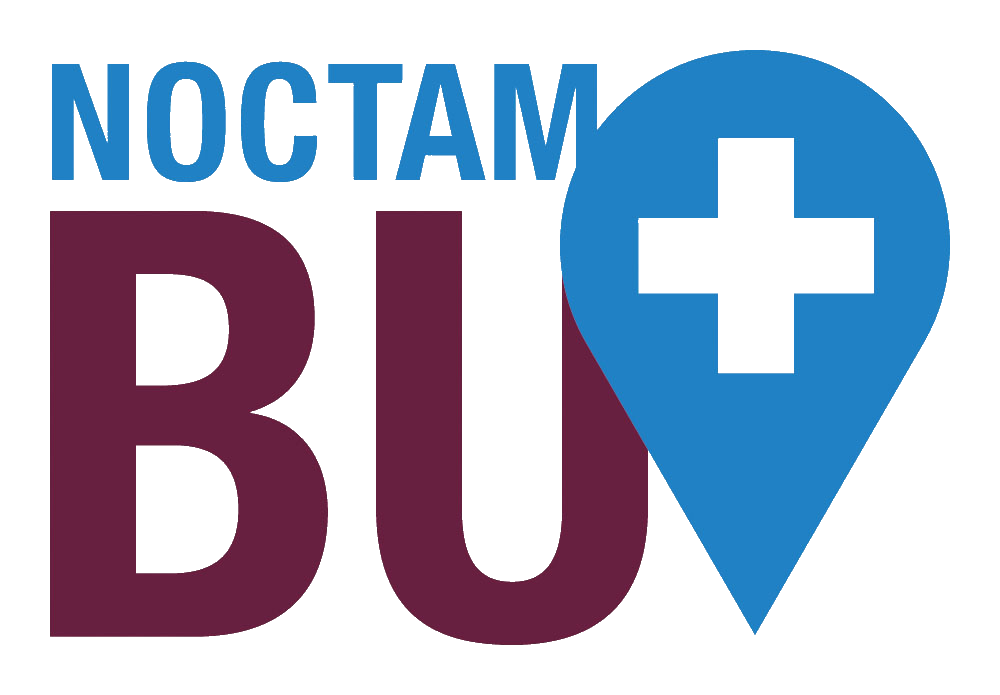Journée mondiale de la justice sociale

Chaque semaine, la BU du campus de Schœlcher vous propose une sélection de livres, revues, BD, DVD... à lire et à emprunter à l'espace Découverte dans le hall de la BU.
Cette semaine, découvrez « Justice sociale : état des lieux et perspectives »
La justice sociale est un objectif affirmé de l'Organisation internationale du travail et sa raison d'être. La croissance économique ne peut mener à un véritable développement sans la justice sociale. Le développement économique peut être une des conditions du progrès social. La justice sociale inscrite depuis 1919 dans la constitution de l'OIT reste toujours un objectif à atteindre. Avec la création de l'OMC en 1995, l’OIT a dû réaffirmer sa position. Avec la « Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail » de 1998, elle rappelle que « la croissance économique est essentielle, mais n’est pas suffisante pour assurer l’équité, le progrès social et l’éradication de la pauvreté ». Malheureusement, tous les efforts de l'OIT pour insérer cette justice sociale dans l'économie se heurtent au fait qu'elle n'a aucun moyen de contrainte sur les gouvernements et les multinationales. A l'occasion de la Journée mondiale de la justice sociale, le 20 février 2024, l'actuel Directeur général de l'OIT, M. Gilbert F. Houngbo, déclarait que le moment était venu de placer les besoins sociaux au même niveau que les préoccupations économiques et environnementales. Aujourd'hui, dans un contexte social difficile en France, en Europe, et plus globalement dans le monde, la BU au travers de diverses ressources vous propose un regard multiple sur cette cause.
Les BU vous proposent ces titres, parmi beaucoup d’autres, avec un lien vers le livre sur le catalogue de la BU qui vous permettra de localiser ces références dans nos rayonnages.
En rayons à la BU
- Où est passée la justice sociale ? : de l’égalité aux tâtonnements / Thomas Amadieu et al. Villeneuve d’Ascq : Presses universitaires du Septentrion, 2019. Cote 303.372 OUE
 Face à l'accroissement des inégalités en France et dans le monde, cette question devient brûlante. À l'aide de données d'enquête en France comme dans les points "chauds" du globe, ce livre analyse l'ampleur de la crise des modèles de justice et singulièrement du principe d'égalité. En partant des acteurs ordinaires, des mouvements sociaux, des contextes concrets, il dessine le kaléidoscope des tâtonnements et réinventions en cours autour de ces enjeux. Il permet ainsi d'interroger les fondements quotidiens de la démocratie sociale et politique de notre temps.
Face à l'accroissement des inégalités en France et dans le monde, cette question devient brûlante. À l'aide de données d'enquête en France comme dans les points "chauds" du globe, ce livre analyse l'ampleur de la crise des modèles de justice et singulièrement du principe d'égalité. En partant des acteurs ordinaires, des mouvements sociaux, des contextes concrets, il dessine le kaléidoscope des tâtonnements et réinventions en cours autour de ces enjeux. Il permet ainsi d'interroger les fondements quotidiens de la démocratie sociale et politique de notre temps.
- Les places et les chances : repenser la justice sociale / François Dubet. Paris : Seuil, 2010. Cote 305 DUB
 Il y a deux manières de concevoir la justice sociale. La première, l’égalité des places, vise à réduire les inégalités entre les différentes positions sociales. La seconde, l’égalité des chances, cherche à permettre aux individus d’atteindre les meilleures positions au terme d’une compétition équitable. Aujourd’hui, en France comme ailleurs, cette dernière conception tend à devenir hégémonique. Mais, si elle répond au désir d’autonomie des individus, l’égalité des chances s’accommode de l’existence et même du développement des inégalités. Contre l’air du temps, François Dubet plaide en faveur du modèle des places : celui-ci combat résolument les inégalités et accroît la cohésion de la société. En montrant comment on peut promouvoir la justice sociale sans tout sacrifier à la compétition méritocratique, ce brillant essai œuvre à la reconstruction intellectuelle de la gauche.
Il y a deux manières de concevoir la justice sociale. La première, l’égalité des places, vise à réduire les inégalités entre les différentes positions sociales. La seconde, l’égalité des chances, cherche à permettre aux individus d’atteindre les meilleures positions au terme d’une compétition équitable. Aujourd’hui, en France comme ailleurs, cette dernière conception tend à devenir hégémonique. Mais, si elle répond au désir d’autonomie des individus, l’égalité des chances s’accommode de l’existence et même du développement des inégalités. Contre l’air du temps, François Dubet plaide en faveur du modèle des places : celui-ci combat résolument les inégalités et accroît la cohésion de la société. En montrant comment on peut promouvoir la justice sociale sans tout sacrifier à la compétition méritocratique, ce brillant essai œuvre à la reconstruction intellectuelle de la gauche.
- Théories du multiculturalisme : un parcours entre philosophie et sciences sociales / Francesco Fistetti et al. Paris : Éd. La Découverte M.A.U.S.S., 2009. Cote 306.4 FIS
 Le temps est révolu où l'on pouvait croire que la dénué catie ne peut se réaliser que dans le cadre d'un Etat-nation. Superposant sur un territoire, un peuple. Une langue, une culture et une religion, transcendante ou séculière. La tâche prioritaire est désormais de penser les modalités plausibles de la coexistence au sein d'un même Etat et entre Etats de traditions culturelles diverses, traversant les frontières politiques.
Le temps est révolu où l'on pouvait croire que la dénué catie ne peut se réaliser que dans le cadre d'un Etat-nation. Superposant sur un territoire, un peuple. Une langue, une culture et une religion, transcendante ou séculière. La tâche prioritaire est désormais de penser les modalités plausibles de la coexistence au sein d'un même Etat et entre Etats de traditions culturelles diverses, traversant les frontières politiques.
Sur ce point décisif, le débat reste en France piégé par l'opposition rituelle entre républicanisme et communautarisme. D'où l'importance de ce livre du philosophe Francesco Fistetti, qui élargit considérablement la réflexion en exposant ce qui s'argumente ailleurs sur ce thème, à travers les Cultural Studies, Subaltern Studies, Postcolonial Studies et autres travaux mal connus en France. L'auteur en offre ici, entre philosophie et sciences sociales, une synthèse rigoureuse et pédagogique.
- Regards sur l’avenir de la justice sociale : mélanges à l’occasion du 75e anniversaire de l’OIT / Bureau international du travail. Genève : BIT, 1994. Cote 340.02 MEL oit
 Plusieurs questions clés sont évoquées, notamment l'introduction d'une clause sociale dans les accords commerciaux internationaux, la réglementation sociale de l'économie mondiale, la réinsertion des exclus de l'activité économique, l'importance du tripartisme, la promotion des normes internationales du travail et la nécessité d'améliorer la protection sociale.
Plusieurs questions clés sont évoquées, notamment l'introduction d'une clause sociale dans les accords commerciaux internationaux, la réglementation sociale de l'économie mondiale, la réinsertion des exclus de l'activité économique, l'importance du tripartisme, la promotion des normes internationales du travail et la nécessité d'améliorer la protection sociale.
- La vulnérabilité en droit européen des droits de l’homme : conception(s) et fonction(s) / Caroline Boiteux-Picheral. Limal Bruxelles : Anthemis Nemesis, 2019. Cote 341.48 VUL
 Cet ouvrage est le fruit d'une réflexion collective de juristes issus de différentes branches du droit. Il offre des analyses critiques croisées sur la mise en oeuvre, dans une perspective nationale et internationale, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui a acquis une force contraignante en 2009.
Cet ouvrage est le fruit d'une réflexion collective de juristes issus de différentes branches du droit. Il offre des analyses critiques croisées sur la mise en oeuvre, dans une perspective nationale et internationale, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui a acquis une force contraignante en 2009.
D'une manière générale, les effets de la Charte se font sentir non seulement dans l'ancrage de ses principes dans les constitutions et les législations nationales des États membres de l'Union européenne, mais également dans les décisions des juges à tous les niveaux de juridiction. Ces principes concernent des enjeux de société très débattus, tels que les questions relatives aux travailleurs détachés, à l'euthanasie, à la protection des données personnelles, au droit d'asile et au droit des étrangers, indépendamment des questions plus techniques ayant trait aux garanties procédurales.
- Le travail au XXIe siècle : livre du centenaire de l’Organisation internationale du travail : [colloque international organisé au Collège de France les 26 et 27 février 2019] / Alain Supiot et Cyril Cosme. Ivry-sur-Seine : Les éditions de l’Atelier/Les éditions ouvrières, 2019. Cote 306.36 TRA
 Le travail est aujourd'hui, à l'échelle du monde, le théâtre de trois bouleversements de grande ampleur, qui sont autant de défis à relever : un défi technologique, un défi écologique et un défi institutionnel. Cet ouvrage collectif, qui croise plusieurs disciplines et réunit des chercheurs du monde entier, a pour objet d'analyser chacun de ces défis au prisme de la diversité des expériences et des cultures.
Le travail est aujourd'hui, à l'échelle du monde, le théâtre de trois bouleversements de grande ampleur, qui sont autant de défis à relever : un défi technologique, un défi écologique et un défi institutionnel. Cet ouvrage collectif, qui croise plusieurs disciplines et réunit des chercheurs du monde entier, a pour objet d'analyser chacun de ces défis au prisme de la diversité des expériences et des cultures.
- Les normes internationales du travail entre global et local : étude internationale et comparée de l’interprétation des instruments de l’OIT / Rachid Nacer. Paris : L’Harmattan, 2020. Cote 344.01 NAC
 Le sujet de l'interprétation soulève de nombreuses interrogations, tant en matière institutionnelle que substantielle, à la fois au sein de l'Organisation internationale du travail (OIT) et en-dehors. Le regain d'intérêt pour les travaux de l'instance genevoise conduit à une situation où la question de l'interprétation de ses instruments se trouve renouvelée, complexifiée et fragmentée devant la diversité des acteurs qu'elle implique. Cet ouvrage propose une réflexion pour savoir si cette configuration permet de rendre effectifs des textes adoptés en vue de donner corps à la justice sociale. Sont ainsi analysés différents niveaux dans lesquels les instruments de l'OIT sont susceptibles d'être utilisés, à travers l'étude successive du cadre international puis de situations nationales, sur la base des jurisprudences canadienne, française et sud-africaine.
Le sujet de l'interprétation soulève de nombreuses interrogations, tant en matière institutionnelle que substantielle, à la fois au sein de l'Organisation internationale du travail (OIT) et en-dehors. Le regain d'intérêt pour les travaux de l'instance genevoise conduit à une situation où la question de l'interprétation de ses instruments se trouve renouvelée, complexifiée et fragmentée devant la diversité des acteurs qu'elle implique. Cet ouvrage propose une réflexion pour savoir si cette configuration permet de rendre effectifs des textes adoptés en vue de donner corps à la justice sociale. Sont ainsi analysés différents niveaux dans lesquels les instruments de l'OIT sont susceptibles d'être utilisés, à travers l'étude successive du cadre international puis de situations nationales, sur la base des jurisprudences canadienne, française et sud-africaine.
- C’était à Tigony : roman / Olympe Bhêly-Quénum. Abidjan Paris : Nouv. éd. Ivoiriennes Présence africaine, 2000. Cote AF 843.91 BHE
 Une phrase d'Aristote déclenche au cœur de ce roman une excitation sensuelle, tandis que la foule descendue dans les rues de Wanakawa manifeste en faveur des droits sociaux. Le tocsin se met à tinter, l'angoisse s'empare du pays. C'était à Tigony est campé dans une région que l'auteur semble bien connaître. Les principaux protagonistes sont une géophysicienne et son mari mutés en Afrique, un jeune Africain vendeur de journaux, l'envoyé permanent d'un grand quotidien et une Ethiopienne qui déclame en hébreu le Cantique des Cantiques et l’Haggadah. La découverte d'une mine d'or et son exploitation par un consortium international fait prendre conscience que les richesses du sous-sol et du sol du pays ne devraient pas être au seul bénéfice de l'Occident. Tandis qu'une sourde tragédie s'amorce au pied de la mine, les droits sociaux gagnent du terrain. Dans C'était à Tigony, Olympe Bhêly-Quenum pose l'un des problèmes cruciaux du continent.
Une phrase d'Aristote déclenche au cœur de ce roman une excitation sensuelle, tandis que la foule descendue dans les rues de Wanakawa manifeste en faveur des droits sociaux. Le tocsin se met à tinter, l'angoisse s'empare du pays. C'était à Tigony est campé dans une région que l'auteur semble bien connaître. Les principaux protagonistes sont une géophysicienne et son mari mutés en Afrique, un jeune Africain vendeur de journaux, l'envoyé permanent d'un grand quotidien et une Ethiopienne qui déclame en hébreu le Cantique des Cantiques et l’Haggadah. La découverte d'une mine d'or et son exploitation par un consortium international fait prendre conscience que les richesses du sous-sol et du sol du pays ne devraient pas être au seul bénéfice de l'Occident. Tandis qu'une sourde tragédie s'amorce au pied de la mine, les droits sociaux gagnent du terrain. Dans C'était à Tigony, Olympe Bhêly-Quenum pose l'un des problèmes cruciaux du continent.
- Ignorance scientifique et inaction publique : les politiques de santé au travail / Emmanuel Henry. Paris : Presses de Sciences Po, 2017. Cote 363.1 HEN
 Sait-on qu'entre 14 000 et 30 000 nouveaux cas de cancers professionnels se déclarent chaque année ? N'est-il pas surprenant que l'activité économique soit la cause de milliers de malades et de morts et que personne n'en parle ? Comment expliquer qu’à l’exception du scandale de l’amiante, la question des substances toxiques et processus industriels dangereux soit éludée du débat public ?
Sait-on qu'entre 14 000 et 30 000 nouveaux cas de cancers professionnels se déclarent chaque année ? N'est-il pas surprenant que l'activité économique soit la cause de milliers de malades et de morts et que personne n'en parle ? Comment expliquer qu’à l’exception du scandale de l’amiante, la question des substances toxiques et processus industriels dangereux soit éludée du débat public ?
- Droit de l’aide et de l’action sociales / Michel Borgetto et Robert Lafore. 11e édition. Paris La Défense : LGDJ, un savoir-faire de Lextenso, 2021. Cote 344.03 BOR
 Conçus comme compléments de la Sécurité sociale à destination de fractions ciblées de la population (enfance en danger, personnes âgées, handicapées…), les dispositifs nés des lois d’assistance de la IIIe République connaissent, depuis plusieurs décennies, un développement continu. L’émergence des phénomènes d’exclusion, les effets du vieillissement et de la dépendance, l’enracinement de difficultés diverses en matière d’accès au logement, à l’emploi ou encore aux soins ont conduit non seulement à renforcer les politiques d’aide aux catégories traditionnelles de l’assistance, mais aussi à développer des interventions de plus en plus complexes pour assurer a minima la concrétisation de droits sociaux élémentaires.
Conçus comme compléments de la Sécurité sociale à destination de fractions ciblées de la population (enfance en danger, personnes âgées, handicapées…), les dispositifs nés des lois d’assistance de la IIIe République connaissent, depuis plusieurs décennies, un développement continu. L’émergence des phénomènes d’exclusion, les effets du vieillissement et de la dépendance, l’enracinement de difficultés diverses en matière d’accès au logement, à l’emploi ou encore aux soins ont conduit non seulement à renforcer les politiques d’aide aux catégories traditionnelles de l’assistance, mais aussi à développer des interventions de plus en plus complexes pour assurer a minima la concrétisation de droits sociaux élémentaires.
- L’accès à la justice sociale : la place du juge et des corps intermédiaires : approche comparative et internationale / Daugareilh, Isabelle. Bruxelles : Bruylant, 2019. Cote 347.01 ACC
 Juge et corps intermédiaires dans l'accès à la justice sociale. Approche comparative et internationale du sujet.
Juge et corps intermédiaires dans l'accès à la justice sociale. Approche comparative et internationale du sujet.
L'ouvrage analyse les acteurs de la justice sociale que sont le juge et les corps intermédiaires. Il s'appuie sur divers systèmes juridiques en Europe, en Afrique et en Amérique ainsi que sur des situations spécifiques du XXIème siècle.
- De gré et de force : comment l’État expulse les pauvres / Camille François. Paris : La Découverte, 2023
 Les expulsions locatives jettent chaque année en France des milliers de familles pauvres à la rue, dans une indifférence quasi générale. Pourtant, ces procédures sont au cœur de l'accroissement de la pauvreté et des inégalités sociales. Et leur nombre a augmenté au cours des vingt dernières années. À partir d'une longue enquête de terrain, ce livre s'intéresse aux institutions et aux " petites mains " chargées de réaliser les expulsions. Il décrit la manière dont la violence légitime de l'État s'exerce sur les familles menacées de délogement, en retraçant les différentes étapes auxquelles elles sont confrontées : les services de recouvrement où les employés des bailleurs essaient de leur faire rembourser leur dette, les tribunaux où les juges prennent les décisions d'expulsion, les services de préfecture et de police chargés d'utiliser la force publique pour les déloger de leur domicile. En expliquant pourquoi certaines familles sont plus souvent expulsées que d'autres et comment les agents de l'État les contraignent, à la fois de gré et de force, à quitter leur logement, il met ainsi en lumière une violence légitime moins visible que la répression des manifestations ou que des interpellations policières, mais tout aussi efficace dans le maintien de l'ordre social.
Les expulsions locatives jettent chaque année en France des milliers de familles pauvres à la rue, dans une indifférence quasi générale. Pourtant, ces procédures sont au cœur de l'accroissement de la pauvreté et des inégalités sociales. Et leur nombre a augmenté au cours des vingt dernières années. À partir d'une longue enquête de terrain, ce livre s'intéresse aux institutions et aux " petites mains " chargées de réaliser les expulsions. Il décrit la manière dont la violence légitime de l'État s'exerce sur les familles menacées de délogement, en retraçant les différentes étapes auxquelles elles sont confrontées : les services de recouvrement où les employés des bailleurs essaient de leur faire rembourser leur dette, les tribunaux où les juges prennent les décisions d'expulsion, les services de préfecture et de police chargés d'utiliser la force publique pour les déloger de leur domicile. En expliquant pourquoi certaines familles sont plus souvent expulsées que d'autres et comment les agents de l'État les contraignent, à la fois de gré et de force, à quitter leur logement, il met ainsi en lumière une violence légitime moins visible que la répression des manifestations ou que des interpellations policières, mais tout aussi efficace dans le maintien de l'ordre social.
Loin d'être une fatalité, ces expulsions locatives constituent une réalité éminemment politique, qui interroge la place du capital immobilier et de l'État dans la précarisation des classes populaires aujourd'hui. Une réalité contre laquelle il est possible d'agir.
- Capitalisme et progrès social / Anton Brender
 Dans les pays les plus avancés, le progrès social est en panne. Face à la montée presque générale des inégalités, face à la stagnation des revenus d'une large partie de leurs populations, face aussi aux dommages de plus en plus visibles causés à la planète par leur développement passé, ce constat s'impose. En attribuer la faute au capitalisme, sur lequel ce développement s'est fondé, serait pourtant une erreur : il n'est pas plus responsable de la panne actuelle qu'il ne l'a été hier des progrès accomplis. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les populations occidentales ont connu une amélioration, profonde et largement partagée, de leurs conditions de vie, parce que, au terme d'une longue et tumultueuse histoire, elles ont réussi à maîtriser la force productive du capitalisme. Les années 1980 ont toutefois été celles du triomphe de l'idéologie libérale : face à la mondialisation et aux changements techniques qui s'esquissent alors, les sociétés occidentales auraient dû redoubler d'efforts pour rester dans un rapport de forces favorable avec le capitalisme. Elles ont préféré laisser faire. Après quarante ans de dérive, est-il trop tard pour reprendre la barre ?
Dans les pays les plus avancés, le progrès social est en panne. Face à la montée presque générale des inégalités, face à la stagnation des revenus d'une large partie de leurs populations, face aussi aux dommages de plus en plus visibles causés à la planète par leur développement passé, ce constat s'impose. En attribuer la faute au capitalisme, sur lequel ce développement s'est fondé, serait pourtant une erreur : il n'est pas plus responsable de la panne actuelle qu'il ne l'a été hier des progrès accomplis. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les populations occidentales ont connu une amélioration, profonde et largement partagée, de leurs conditions de vie, parce que, au terme d'une longue et tumultueuse histoire, elles ont réussi à maîtriser la force productive du capitalisme. Les années 1980 ont toutefois été celles du triomphe de l'idéologie libérale : face à la mondialisation et aux changements techniques qui s'esquissent alors, les sociétés occidentales auraient dû redoubler d'efforts pour rester dans un rapport de forces favorable avec le capitalisme. Elles ont préféré laisser faire. Après quarante ans de dérive, est-il trop tard pour reprendre la barre ?
En ligne à la BU
- Kott, Sandrine « L’Organisation internationale du Travail, entre justice sociale et développement économique (1920-2020) ». Études internationales 54, no 1 (2023) : 157–180.
- Connac, Sylvain. Enseigner sans exclure ; La pédagogie du colibri, Editions ESF, 2017, 225 p.
- Bachand, Charles-Antoine « Malet, R. et Baocun, L. (dir.). (2021). Politiques éducatives, diversité et justice sociale. Peter Lang ». Revue des sciences de l’éducation 48, no 2 (2022).
- Bellavance, Éric « (In)justice sociale : héritage et échos des prophètes bibliques ». Théologiques 24, no 1 (2016) : 7–14.
- Bernheim, Emmanuelle « Les juges, acteurs et actrices de la justice sociale ». Lex Electronica 27, no 2 (2022) : 30–44.
- Valade, Bernard. Justice sociale. Encyclopaedia universalis,
- Mathilde Unger et al., « La justice sociale dans l’Union européenne : citoyenneté et droits au-delà de l’Etat », HALSHS : archive ouverte en Sciences de l’Homme et de la Société - notices sans texte intégral, ID : 10670/1.f2cf23.
- François Rousseau et al., « Dossier - Le droit pénal au secours de la justice sociale. Variations autour du procès France Télécom », Pergola, pépinière de revues du Grand Ouest en libre accès, ID : 10.56078/amplitude-droit.419
Autres ressources sur le web :
- OIT, Vers un nouveau contrat social, 2024
- La forge numérique. (2024, 12 juin). L'OIT, une perspective centenaire sur le travail et la justice sociale. [Podcast]. Canal-U.
- Luc Boltanski. Univ Bordeaux. (2013, 30 mai). Croissance des inégalités, effacement des classes sociales ? Trente années d'embarras sociologiques , in Inégalités et Justice sociale. [Vidéo]. Canal-U
- Arte regards "A Berlin, les oubliés de l'ascenseur social", Emission du 23 janvier 2025